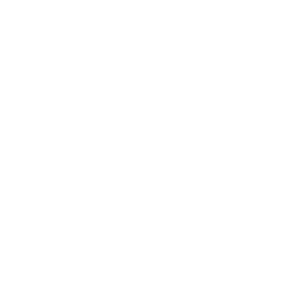Quelques exemples de conflits interculturels.
Au cours du bilan de la première journée d’une rencontre franco – germano – tchèque, les participants allemands font des critiques de l’animation et formulent des demandes en terme de méthode et de contenu. Les participants français, après avoir évoqué la contrainte du temps, se demandent s’il ne serait pas possible que les animateurs introduisent telle méthode de travail, s’il serait envisageable de…etc. Les participants tchèques disent qu’ils n’ont rien de spécial à dire. Une Française exprime alors qu’elle ne supporte pas cette façon de ne pas se positionner. Plus tard, une des Tchèques lui répondra qu’elle ne voit pas pourquoi elle devrait se sentir obligée de se positionner…
Dans un stage sur l’interculturel, les participants doivent construire, avec des chaises et sans parler, leur représentation du “pouvoir” . Les stagiaires français dans un enthousiasme unanime construisent une pyramide et placent quatre chaises à une assez bonne distance de la pyramide, en vis à vis. Des Sénégalais forment un cercle : une chaise est plus haute que les autres, quatre chaises sont mises de part et d’autre de la première, trois autres sont renversées. Les stagiaires français parlent de” tyrannie”, “d’oppression”, de “magie” en commentant cette figure. Les stagiaires sénégalais parle de “soumission”, “d’écrasement”, “d’instabilité”, de “distance entre les sujets et les chefs” à propos de la construction des Français !
Quand avec des assiettes on demande à des Français de construire leur représentation du groupe, ils font un cercle et hésitent à en mettre une au milieu. Les Allemands répartissent les assiettes par deux ou trois, en empilent certaines, d’autres non, avec plus ou moins de distance entre les petits groupes ainsi formés…
Quels rapports y a-t-il entre ces exercices et la réalité me direz-vous ? Que peut-on en conclure pour les rapports quotidiens ?
Si on ne prend pas garde aux conflits, ou si on les provoque, dans une rencontre interculturelle, ils vont d’abords se manifester par des “stéréotypes”, puis apparaîtront des “jugements de valeurs”. Mais tout cela cache encore en réalité des différences plus profondes.
Stéréotypes et préjugés
Le stéréotype procède par réduction d’un comportement, d’une habitude (culinaire, vestimentaire, rituelle..) d’une ou plusieurs personnes d’un groupe donné à une nationalité : les Français mangent de la baguette, les US-américains mâchent du chewing-gum à longueur de journée, les Allemands sont rigides…Ces stéréotypes en disent plus sur notre propre rapport à l’autre que sur l’autre lui-même. Car nous jugeons à partir de nos propres critères, nos propres références. En outre ils confondent nationalité et identité : chaque nationalité recouvre plusieurs identités culturelles (en France il y a des Alsaciens, Bretons, Occitans, Basques, sans compter les Polonais, les Italiens, Algériens, Marocains d’origine…). Enfin, il est nécessaire de prendre en compte qu’il y a aussi des cultures différentes selon qu’on est d’origine ouvrière ou bourgeoise, qu’on a une formation universitaire ou manuelle, qu’on est de la ville ou de la campagne.
Les préjugés procèdent de la même attitude : parce que l’étranger est noir de peau, alors il faut que je me méfie ; parce qu’il est habillé différemment de moi, qu’il mange avec ses doigts, qu’il danse et chante tard la nuit, alors je suis en insécurité. Mon dérangement peut-être légitime, il ne m’en autorise pas pour autant à dénigrer l’autre. Et très vite, comme légitimation de ces « dénigrements » apparaissent des conflits de valeurs.
Les conflits de valeurs
“Tyrannie”, “oppression”, “magie”, “soumission”, “distance”, “non-positionnement”… sont des jugements de valeurs : nous voulons exprimer par là que nous n’avons pas les mêmes références, les mêmes valeurs que les autres. Mais on peut constater que les jugements portés par les Français sur la représentation du pouvoir d’un Sénégalais – et inversement – sont finalement relativement symétriques. Mêmes difficultés entre les Allemands qui critiquent facilement les animateurs, les Français qui critiquent, mais indirectement, en louvoyant, sans confronter, et les Tchèques qui ne critiquent pas. Tous ont des valeurs différentes quant à la place de l’animateur, voire du chef. Il est donc difficile pour les Français (qui ont vécu plusieurs révolutions, coupé la tête du roi !) d’accepter que les Tchèques ne se positionnent pas par rapport aux animateurs (mais quand on a subi 50 ans de culture soviétique comment ne pas se protéger ?) Les Allemands, de leur côté, se moquent un peu de la “diplomatie” française et sont plus directs car ils ne craignent pas une montée aux enchères des conflits, eux dont l’histoire est faite de multiples négociations, d’une longue tradition du consensus (l’Allemande « fédérale » était à l’origine un ensemble de petites principautés). C’est aussi pourquoi ils peuvent concevoir un groupe sans centre ni frontières, alors que les Français, avec leur centralisme réputé, n’imaginent pas un groupe sans circonférence et sans centre, ni d’ailleurs un pouvoir qui ne soit pas pyramidal et distant Pour les Sénégalais, ce même pouvoir ne peut être que géré collectivement !
La face cachée de toute culture : les antagonismes fondamentaux
Les valeurs que sont sensées mettre en œuvre chaque culture s’articulent en fait autour d’ “antagonismes fondamentaux” (1). Quand nous Français, mettons en avant la liberté, nous partons d’une conception “individualiste” de la personne, alors que les Sénégalais ou les Kanaks vont avoir comme présupposé une conception “communautaire” de la personne : ils intègrent la contrainte communautaire comme un élément constitutif de leurs valeurs.
La vision française du groupe (un cercle avec un centre) tend à gérer la distance entre les membres et le “chef” du groupe de façon égalitaire, alors que la vision allemande met l’accent que la qualité de la relation. Il y a donc bien une problématique commune de rapport à la distance. Cet antagonisme “proximité-distance” est, comme pour tout antagonisme, composé de deux pôles qui sont comme les deux faces d’une même pièce de monnaie. On peut même dire que la face de l’un correspond à la face “cachée”, “inconsciente”, de l’autre : d’où les réactions de résistance provoquées par la confrontation interculturelle ! Car cette dernière questionne en fait notre identité : quels sont les fondements de notre identité si les autres peuvent, en toute légitimité, faire, penser, différemment de nous ?
Toutes les cultures posent les mêmes questions, mais elle apportent des réponses différentes. Les antagonismes constituent les questions, chaque pôle représentant une des deux composantes de la réponse possible. Et chaque composante va se combiner avec les pôles d’autres antagonismes pour créer un « kaléidoscope culturel ».
Repérer ses propres préférences culturelles pour apprivoiser son identité
Toute pratique “interculturelle” suppose donc un travail de repérage de ses propres préférences culturelles. C’est quand je me mets à justifier mes comportements ou modes de pensée que je dévoile, à mon corps défendant, ma propre culture. En tant qu’Occidental, j’aurai forcément des conflits avec des personnes d’une culture africaine ou asiatique parce que mes présupposés sont toujours “la liberté”, “l’individu”, “la production”, le “temps cadre” (où l’action s’inscrit dans un temps structuré), alors qu’en face on réagira à partir de “la contrainte”, du “collectif”, de la “relation”, du “temps événement” (c’est l’événement, même imprévu, qui structure le temps) etc.
Cette pratique suppose en outre un travail d’acceptation de mon « incomplétude » au niveau conscient. Sinon, le fait de rencontrer une autre conception du monde va me confronter à une crise identitaire. Le racisme va se nourrir de cette peur de la différence, où c’est la peur qui exacerbe la différence et non l’inverse. Reconnaître l’autre comme différent ne suppose pas que je doive renoncer à mon identité, mais que je doive accepter qu’il y a autant de fondements identitaires légitimes que de cultures.
À partir de cette confrontation, je vais pouvoir interroger ma culture, mon identité pour voir ce que les “préférences” des autres peuvent me révéler de moi-même, m’apporter, en quoi les pratiques qu’ils ont déduites de ces préférences, vont pouvoir diversifier, enrichir, les miennes. Et ce n’est qu’à partir de cette prise de conscience, qu’à partir de cette mise en mots des différences que je vais pouvoir négocier avec eux des pratiques communes. Ce qui rend par contre impraticable la négociation, c’est quand ce qui me différencie en apparence, mais me rapproche de l’autre en réalité, reste implicite, non-dit, refoulé !
Cette approche devrait nous permettre de relire “la déclaration universelle des droits de l’Homme”. On éviterait de tomber dans le travers du “relativisme culturel” si l’on prenait le temps de vérifier ce que chaque culture entend par “homme”, “femme”, “droit” etc…Et l’on pourrait alors comprendre ce qui, derrière une telle unité de façade, peut expliquer que des pratiques soient aussi différentes, voire contradictoires, avec l’esprit de la charte !
Hervé Ott
Formateur – consultant en « Approche et transformation constructives des conflits »
(1) cf. J. Demorgon Complexité des cultures et de l’interculturel Anthropos 1996 320 p.
On lira aussi avec beaucoup de facilité les livres de T.E Hall en commençant par “La dimension cachée” collection Point, Seuil 1971, 240 p.
Une voie d’accès à sa propre culture
Article paru dans Non-Violence Actualité – 2003 –