Article paru dans la Revue de psychologie de la motivation. 2002.N° 34
D’où nous vient la capacité de répondre à la demande d’aide ? Je situerai ce moteur dans l’émotion « compassion » qui génère en nous le sentiment d’empathie, c’est-à-dire, cette capacité de « sentir avec ». C’est pour moi le fondement de l’amour.
Mais il y a aussi le « besoin » d’aider, ce désir compulsif de venir en aide aux autres quand on estime qu’ils ont absolument besoin de nous, même lorsqu’ils n’ont rien demandé. Il a servi a justifier de très nombreuses entreprises de domina-tion.
Si nous sommes sans cesse sollicités pour venir en aide, nous ne sommes pas toujours assez lucides pour distinguer qui bénéficie le plus de cette aide. Car si « l’enfer est pavé de bonnes intentions », c’est bien parce que trop souvent nous confondons notre peur de mal aider avec le besoin d’aide plus ou moins formulé par les autres.
Ma perspective est celle des conflits. Je développe à travers mes activités de formateur des outils pour une « Approche et transformation constructives des conflits ». J’entends par là, une compréhension de la dynamique des conflits et l’élaboration de méthodes pour les rendre constructifs, même quand ils se mani-festent de façon destructive : ils recèlent une énergie à mettre au service de la vie, à détourner du service de la mort. En ce sens, je suis redevable à de nombreuses personnes comme K. Rogers, R. Girard, Gordon ou M. Rosenberg, au courant de la médiation (J. Morineau, J.-F. Six) et à des acteurs sociaux comme M.K. Gandhi, M.-L. King. J’ai aussi beaucoup appris à travers mon implication directe dans une longue résistance « non-violente », celle des Paysans du Larzac. Puis j’ai été amené à intervenir comme formateur dans des situations de guerre civile (au Liban), de mouvements de libération (Nouvelle-Calédonie), de défense des droits des hu-mains (Tchad) etc.
J. Galtung (*) distingue d’abord trois grands niveaux de conflits : autour de la personne (l’intra et l’inter-personnel), autour des structures (depuis le groupe jus-qu’à l’ONU, en passant par la famille, le clan, le peuple, l’association, l’entreprise, l’État) et autour des cultures, des systèmes de croyances (faits de représentations, de codes, de valeurs). Je repère des dynamiques communes à ces trois niveaux et travaille donc à élaborer des outils de compréhension et de transformation des conflits, distincts selon les niveaux mais inspirés des mêmes principes.
J’interprète les conflits comme les symptômes d’un changement qui n’arrive pas à se dire, à se négocier. Ces symptômes (maladies, violences urbaines, guerres ou génocides) reflètent donc à l’extérieur, un conflit intérieur non-dit, non-négocié, refoulé. La recherche de « solutions » pour l’extérieur nécessitera donc de révéler, de mettre en mots, l’intérieur.
Je distingue, après R. Girard [1], les » conflits d’intérêts » (légitimes, négo-ciables, cadrés par des contrats, règlements ou lois) des » conflits d’identités » (de-puis l’injure jusqu’au meurtre, en passant par le jugement de personne, les généra-lisations et autres formes de dévalorisation et de domination manipulées par les passions). Ces derniers révèlent plus de symétrie (d’identique, de mimétisme) qu’on ne veut ou peut l’admettre. Ce n’est qu’en » cassant la symétrie des affects, des comportements et des arguments, par toutes formes d’interventions paradoxa-les, que l’on permet le « retour à l’objet du conflit d’intérêt », et rétablit la confiance nécessaire à toute négociation. A quelque niveau qu’on se situe (personnel, struc-turel ou culturel) on pourra identifier une problématique de « peurs fondamentales » qui renvoient à des « besoins fondamentaux » frustrés. Ces peurs transforment les différences de forme en incompatibilités de fond et justifient sexisme, racisme, guerres et autres formes d’exclusions.
Enfin, ce travail de transformation constructive passe par l’intervention de tiers médiateurs, lesquels permettent ce recréer les conditions de la confiance, du dialogue et de la négociation.
Je vais essayer de décliner cela dans quatre domaines.
Aide-toi et… ça t’aidera !
Dans le travail sur ses propres conflits, il est possible de se doter d’outils.
En acceptant d’abord que les « conflits d’identité » que j’ai avec les autres, renvoient à mes propres conflits intérieurs. Quand je juge ou condamne une per-sonne de mon entourage, c’est parce que ce qu’elle dit ou fait me touche en un point extrêmement sensible de moi-même. J’insiste que c’est quand je juge ou condamne. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, j’ai pu constater que, ce que je dénonce avec violence, me renvoie en fait à moi-même. Je sais les résistances que peut provoquer ce genre d’affirmation, mais toutes les occasions (pour moi-même ou en formation) qui me sont présentées me confirment dans sa justesse. Chaque conflit d’identité m’ouvre donc l’accès à mes propres souffrances, me permet une prise de conscience des blessures non cicatrisées. J’utilise pour l’illustrer cette formule qui a l’avantage d’être facilement mémorisable et de bien distinguer les trois niveaux :
![]() du jugement de personne : « tu es bête » ;
du jugement de personne : « tu es bête » ;
![]() du jugement de comportement : « tu as fait une bêtise » ;
du jugement de comportement : « tu as fait une bêtise » ;
![]() et du ressenti : « je suis embêté ».
et du ressenti : « je suis embêté ».
Ces blessures, je les résume, à la suite de C. Rojzman [2] sous forme de « peurs » qui manifestent des besoins fondamentaux, frustrés. Ainsi au besoin d’amour, de reconnaissance, de sécurité, d’autonomie, d’orientation et de créativi-té – transcendance, correspondent respectivement les peurs d’abandon, de rejet, d’agression, d’envahissement, de perte des repères et de perte de sens. En prenant conscience de mes peurs, je peux reconnaître mes besoins frustrés. À la différence des besoins, les peurs ne sont pas négociables, elles ne peuvent se » dissoudre « , se » résoudre (?) » que dans l’écoute bienveillante, l’accueil et la verbalisation : met-tre en mots pour guérir les maux . Ceci est valable même dans le cas de la maladie [3].
Même en travaillant longtemps sur elles, ces peurs ne sont probablement pas toutes définitivement » solubles « . Elles provoquent à leur tour des » mécanismes de défense » : si dans ma peur d’être rejeté, je me colle à telle personne, je risque de provoquer chez elle une vraie attitude de rejet. Il importe donc de se forger des » outils de protection » [4] : quand telle peur que je connais, que j’ai apprivoisée, me saisit, je peux utiliser un outil de protection que je me suis choisi, pour la transcender.
Exemple : je suis très souvent agacé par les personnes qui arrivent en retard à leur rendez-vous. Et je n’arrête pas de le leur reprocher, surtout si c’est récurrent. Mais j’ai aussi pris conscience que si je suis moi-même à l’heure, c’est en fournis-sant beaucoup d’efforts, voir même, en prenant des risques pas très raisonnables. Mon rapport au temps est donc blessé. Au lieu de tomber dans l’accusation per-manente qui est mon « mécanisme de défense » (« moi je suis à l’heure et j’ai fait beaucoup d’efforts pour cela, alors que toi tu n’en fais aucun »), j’ai pris l’habitude d’avoir toujours un livre à portée de main, ce qui me permet de ne pas avoir l’impression de « perdre mon temps ». Et vis-à-vis des personnes dont je serais dé-pendant (quand j’ai besoin d’un véhicule par exemple) et dont je connais la diffi-culté à être à l’heure, je donne une heure de rendez-vous qui intègre leur temps de retard habituel. J’ai mis beaucoup de temps à accepter cette démarche tant elle me semblait irrationnelle, mais finalement elle m’est tellement plus confortable ! (*)
Quand il s’agit de travailler sur mon sentiment de toute puissance, sur l’image de moi, sur mon Désir, il m’importe de clarifier quels sont mes modèles – rivaux (**). Et de m’interroger sur ma difficulté à concevoir des perspectives au-tres que celles de la toute-puissance ou celle de l’impuissance. Dans ces deux cas, je cherche à dominer les autres, les situations. Alors que quand je cherche à m’accepter moi, je retrouve de la puissance en moi, pour moi.
Ainsi, les outils essentiels pour travailler sur, et prendre de la distance avec, mes propres peurs sont de plusieurs sortes : faire un travail de perception de mon ressenti, d’accueil non jugeant de mes émotions ; bien identifier les pièges dans lesquels je tombe de préférence (les « mécanismes de défense ») afin de les contourner grâce à des « outils de protection » que je me choisis ; solliciter un vis-à-vis écoutant, reformulant, compatissant, une tierce personne : que ce soit un parte-naire bien veillant, un thérapeute professionnel ou Dieu pour les croyants.
Aider l’autre ?
Il nous arrive souvent de ressentir une gêne à la vue d’un comportement, à l’écoute d’une parole d’une autre personne. Et par crainte de blesser ou par peur d’être contré, nous préférons nous taire. Nous sommes plus habitués à émettre des « jugements », qu’entraînés à communiquer notre ressenti comme tel. Pourtant le ressenti n’engage que moi, alors que le jugement implique l’autre et le « détruit » : il va chercher à se justifier ou attaquer pour se défendre.
Quand j’ai un ressenti désagréable, ça parle de moi, de ma relation à l’autre, mais pas de l’autre. Mon ressenti ne dit strictement rien de l’autre, sauf de l’impact qu’il a sur moi. Partager ce ressenti n’est pas juger l’autre, c’est l’informer de ce qui structure la relation : ce que je fais bien volontiers dans la relation amoureuse par exemple. Ne pas partager ce ressenti appauvrit la relation amoureuse. Il en va de même dans la relation conflictuelle. Cacher mon ressenti désagréable, c’est re-fuser de communiquer sur la relation, sur l’impact que l’autre a sur moi et qui n’engage que moi. Faire preuve d’amour, c’est oser communiquer le ressenti dé-sagréable tout en affirmant vouloir maintenir la relation. À force de garder pour moi ce ressenti désagréable, je vais exploser, à l’occasion d’un événement banal, et » vider mon sac » en disant après coup que » mes mots ont dépassé ma pensée » (***). Les paroles qui ont provoqué les plus grands changements en moi ont été initiés par des personnes qui m’ont confié leurs impressions à mon égard, sans que je ne me sente jugé !
Quand mon fils avait cinq ans, il lui arrivait de me dire, en colère, « t’es con ». Mon souci était alors de lui faire remarquer que je ne lui parlais pas comme cela et ne pouvais tolérer qu’il le fasse à mon égard, mais que je ressentais sa colère et que je voulais bien l’entendre. Il avait alors de très bonnes « raisons » d’être en co-lère : je lui avais promis, et oublié, de jouer avec lui, de lui acheter tel objet etc. Ce qui me permettait de réparer mon oubli bien plus efficacement que son insulte avec une paire de gifles. !
Lorsque l’autre a besoin de moi pour parler, me faire part de ses doutes, de ses peurs, l’attitude la plus constructive est sans doute l’écoute bienveillante, sans critique, sans jugement, sans interprétation, sans projection de mes propres be-soins, doutes ou peurs. Reformuler pour se réentendre va permettre de mieux sen-tir les enjeux de ce qui se passe, de trouver ses propres réponses. Ce ne sont pas mes conseils qui vont lui permettre de « changer » (on ne fait pas changer les autres, et nul ne peut prétendre connaître la « vérité » de l’autre !). C’est ma façon de chan-ger dans ma relation, d’aller vers l’autre sans a priori, sans désir de toute puis-sance, qui va le plus faire bouger l’autre. C’est ma façon de poser honnêtement mes limites qui va l’aider à préciser les siennes. J’échouerai certainement en vou-lant convaincre qu’elle se trompe, telle personne qui tient des propos « racistes ». Mais je serai plus efficace en lui communiquant l’impact de ses propos sur moi, les émotions qu’ils éveillent, les peurs qu’ils provoquent. L’antiracisme n’est-il pas trop souvent chargé de « peurs » symétriques mais rationalisées en « argu-ments » ?
L’autre peut aussi me demander de faire telle ou telle chose, comme, par exemple, de prendre des décisions à sa place, ou de l’aider dans tel ou tel domaine. J’ai le droit de refuser de le faire, mais pas en expliquant que ce n’est pas bon pour lui, pour elle. Ce n’est pas en rationalisant ce qui me gêne que je l’aide, mais en lui disant que je suis émotionnellement incapable d’accepter, ou que je ne suis pas prêt à assumer ce qui m’est demandé. Car de quel droit puis-je juger ce qui est bon ou mauvais pour l’autre ? J’ai plus de chance de l’aider vraiment en l’épuisant dans son désir d’être dépendant-e de moi, en répondant à son besoin jusqu’à plus soif.
Peut-on intervenir dans les conflits des autres ?
Voyons le cas où je suis sollicité par une des deux parties en conflit d’identités : ce qu’elle va me raconter tend à me convaincre que l’autre porte (presque) tous les torts. C’est avec cette connaissance de la moitié du conflit que je vais aborder l’autre en lui proposant de « changer ». Or sa version est tout aussi vraie. Quoi, n’y aurait-il plus de vraies victimes d’une part et de vrais bourreaux d’autre part, d’une seule pièce ? Comment faire pour accepter que nous puissions être l’une et l’autre à la fois ?
Puisqu’un « conflit d’identités » est un système, toute nouvelle personne qui rentre dans le système en prenant partie pour l’un ou l’autre, va renforcer, en toute bonne fois, le système identitaire.
Supposons maintenant qu’on ne me demande rien, que j’apprenne qu’un couple de mes amis divorce, ou que j’assiste dans la rue à une agression. Soit je m’en lave les mains, soit mon sang ne fait qu’un tour et « je prends parti » de fait, tout en affirmant vouloir rester neutre. Ce « parti pris » va m’empêcher d’aider le système relationnel à évoluer. Je peux intervenir comme « sauveur » en choisissant qui est la victime, qui est le salaud : je vais alors m’opposer, voir agresser le salaud et très vite me retrouver victime à mon tour (ce qui renforcera ma conviction !). C’est ce qu’on appelle la dynamique du » triangle dramatique » (*).
Dans le domaine des relations codées, il y a des juges et des avocats, des arbi-tres. Mais dans les relations non formalisées, il n’y a que la confiance qui peut structurer les échanges. Or cette confiance peut être reconstruite à la seule condi-tion que le tiers reste « équidistant » des deux « partenaires » du conflit.
Comment être ce « tiers » face à ce couple de mes amis dont j’apprends qu’il entame une démarche de divorce ? Vais-je chercher et trouver (!) des arguments pour justifier l’attitude de l’un, condamner l’attitude de l’autre ? De quel droit vais-je m’autoriser à m’immiscer dans leur vie privée ? Et pourtant vais-je faire comme si de rien n’était ? Vais-je me rassurer en disant que cela ne me regarde pas. Certes leur vie privée ne me regarde pas, mais la relation que j’entretiens avec eux, elle, me concerne directement. Je suis donc tout à fait habilité à leur commu-niquer, de la façon la plus équilibrée possible, ce qui me touche dans cette rupture, en quoi elle m’affecte. Et je suis aussi en droit de les inviter à une démarche de médiation, non pour les contraindre à faire machine arrière, mais pour les aider à gérer la suite : leurs relations aux enfants, à leurs amis, aux biens à partager…
Comment faire face à cette mère excédée par son gamin qui trépigne dans la queue de la grande surface et puis le bat, plus par crainte du jugement des autres que par nécessité ? De quoi je me mêle si j’interviens ? Mais ai-je le droit de lais-ser battre un enfant ? Qu’est-ce qui m’empêche de consoler l’enfant, de lui parler ? Soit je rouspète intérieurement et condamne cette « mauvaise mère », soit je tends la perche au plus petit sans condamner le grand. Et j’essaye d’entamer la conversa-tion avec la mère sur le thème « comme c’est difficile d’élever ses enfants ! »
Cela paraît peut-être « trop simple », mais je peux, par de nombreux outils de formation et exemples de la vie quotidienne, monter que ce principe est très effi-cace .
Que faire donc, quand il n’est pas possible de rétablir la règle ou le droit, quand il s’agit d’une agression délibérée ? Comment agir en « tiers » qui ne prend parti ni pour l’un ni pour l’autre, mais pour les deux, pour la relation ?
Il existe plusieurs types d’interventions possibles qui permettent de « rompre la symétrie » du conflit d’identités, de le ramener à un conflit d’intérêts en restant impliqué, mais à équidistance des deux protagonistes, pour leur permettre de re-construire une « relation » :
![]() en s’interposant pour protéger physiquement la victime et établir un contact (au moins visuel) avec le bourreau, sans recours à la contrainte. Cela représente une prise de risque, mais elle peut-être calculée ;
en s’interposant pour protéger physiquement la victime et établir un contact (au moins visuel) avec le bourreau, sans recours à la contrainte. Cela représente une prise de risque, mais elle peut-être calculée ;
![]() en intervenant de manière paradoxale pour créer une diversion momentanée, le temps que chacun-e reprenne ses esprits et une position plus constructive ;
en intervenant de manière paradoxale pour créer une diversion momentanée, le temps que chacun-e reprenne ses esprits et une position plus constructive ;
![]() en intervenant comme « médiateur », c’est-à-dire facilitateur et garant du dialo-gue, de la reconstruction de la confiance dans la relation.
en intervenant comme « médiateur », c’est-à-dire facilitateur et garant du dialo-gue, de la reconstruction de la confiance dans la relation.
Les interventions de solidarité : partisanes ou non-partisanes ?
La question est encore plus difficile quand il s’agit de peuples entiers qui sont victimes d’une situation d’injustice, comme dans la guerre ou le colonialisme !
Toute intervention de « solidarité partisane » va de fait, on l’a vu, renforcer les camps adverses et affaiblir les échanges possibles, les ponts encore existants. Elle rend impossible une lecture objective des faits, justifie beaucoup les actes des uns et condamne les mêmes actes des autres. Elle va provoquer la recherche de « super-solutions » tout à fait irréalistes car élaborées sans le concours des adversaires.
La « solidarité non-partisane » va permettre au contraire de garder le contact avec les éléments les plus modérés de chaque camp, de les encourager à coopérer, à s’exprimer et à agir ensemble.
Cette forme d’intervention va permettre de poser de nouveaux « cadres » rela-tionnels. Elle va chercher avant tout à analyser les modes de relations que j’entretiens moi-même, depuis l’extérieur, avec l’environnement de ce conflit : je puis faire pression sur mon gouvernement pour l’inciter à intervenir, je puis rom-pre symboliquement mes coopérations involontaires avec les causes de l’injustice (boycott, grève) et même aller jusqu’à désobéir publiquement aux lois qui protè-gent, de fait, l’injustice. En cherchant en quoi je suis impliqué indirectement dans ce conflit, je vais trouver les leviers à agir pour faire bouger mon entourage et mo-difier l’environnement du conflit. Ainsi je puis, de l’extérieur, renforcer la pression qui fera bouger les deux camps au lieu de chercher à renforcer la pression d’un camp sur l’autre.
C’est ce que j’ai su faire lorsque, spectateur d’un conflit d’identités entre deux groupes de personnes auxquelles j’étais lié, j’ai entamé un jeûne, pour les in-viter à avoir recours à une médiation. En fait, cette interpellation a mobilisé d’autres personnes liées à ces deux groupes, qui ont permis un dénouement heu-reux. Mais en d’autres circonstances, je n’ai aps su prendre suffisamment de dis-tance critique pour adopter cette attitude.
Pour conclure
Globalement, cette approche des conflits n’est pas très nouvelle, elle est déjà ins-crite dans notre culture (et pas seulement la nôtre) et est confirmée par les sciences sociales humanistes. Par contre c’est dans la façon de détailler ses enjeux et les ou-tils pour la mettre en œuvre dans un processus de formation que peut être revendi-quée une certaine nouveauté.
Là où elle peut paraître dérangeante, c’est dans la notion de symétrie, spécifique aux conflits d’identités. Elle serait bien entendu insupportable si cette notion ser-vait in fine à renvoyer dos à dos les protagonistes. Mais la référence permanente au tiers-solidaire permet justement d’éviter ce danger. Et il serait possible, dans une autre perspective, de démontrer en quoi cette façon d’aborder les conflits peut être politiquement radicale. Les conflits sont la trame de la vie des individus, des groupes, des nations. Il serait grand temps de travailler à repenser nos façons de faire et de penser.
Bibliographie
[1] R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset 1978.
[2] C. Rojzman, La peur, la haine et la démocratie, DDB.
[3] Ph. Dransart, La maladie cherche à me guérir, Ed Mercure Dauphinois, 1999).
[4] C. Portelance, La liberté dans la relation affective Les éditions du CRAM, 1996
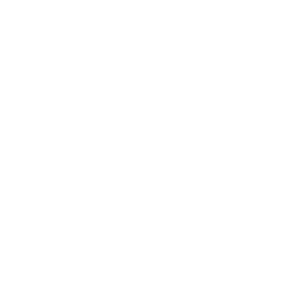
Laisser un commentaire