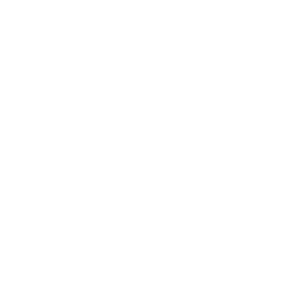Grand ou petit, le désaccord fait partie de la vie. Est-il forcément violent ? Elizabeth Clerc et Étienne Bufquin, formateurs et consultants, nous présentent une approche constructive pour en tirer profit. […]
Aurore Aimelet
Tout l’article par ici : https://www.psychologies.com/Actualites/Vie-pro/L-ATCC-une-methode-pour-traverser-les-conflits-au-bureau